Quel est ton nom ?
- Séverin Duc
- 9 mai 2017
- 3 min de lecture
Une photo. Un lieu. Haarlem.
Ses immeubles typiques du vieux New York.
Deux habituels panneaux verts nommant le chemin au passant.

Deux noms pour une seule rue ?
Oui, deux noms, deux mémoires pour une seule direction.
Les autorités new-yorkaises auraient pu effacer l'un pour promouvoir l'autre, trancher entre deux visions du monde supposées inconciliables. C'est-à-dire qu'elles auraient pu mettre en bataille deux mémoires, prendre subtilement en otage le passé, à l'opposé de ce qui caractérise sa saine connaissance : le refus de l'aveuglement et de la prise de parti. Sans quoi, c'est notre présent et notre futur qui sont aussi pris en otage.
De l'autre côté de l'Atlantique, la New York du XXe siècle (anciennement Nouvelle Amsterdam fondée par les Hollandais au XVIIe siècle) a évité le dangereux écueil de transformer son passé complexe en mémoire unique d'un camp, entre James Lenox mort dans son lit en 1880 et Malcolm X tombé sous les balles en 1965.

Prolongement nord de la 6th Avenue (elle-même rebaptisée Avenue of the Americas en 1945), la Lenox Avenue tient son nom, à partir de 1887, du philanthrope local James Lenox, fils d'un riche marchand écossais, symbole de l'élite blanche de l'East Coast du XIXe siècle. Un siècle plus tard, en 1987, c'est une toute autre mémoire qui la jouxte et trouve sa marque dans l'univers visible de New York : celle tumultueuse de Malcolm X.
Dans les années 1960, le mouvement des droits civiques culmine aux Etats-Unis et met en ébullition le quartier afro-américain de Haarlem (du nom d'une ville hollandaise). A la croisée de ce combat social et politique, Martin Luther King (portant le nom du réformateur allemand) et Malcolm X (anciennement Malcolm Little) s'opposent sur les moyens et les fins ultimes. Afin de comprendre le second, concentrons-nous sur ses noms.
Il faut dire qu'il parle de lui-même et pour lui-même : X. Son porteur s'en est expliqué dans son Autobiography publiée posthume en 1965 : "Pour moi, mon 'X', remplace le nom du maître-esclave blanc de 'Little' qu'un diable aux yeux bleus appelé 'Little" a imposé à mes ancêtres paternels". Tout est dit, et charge à vous de réfléchir aux tenants et aboutissants du "nom des gens". Dans son désir inaltérable de s'extraire de son histoire traumatique, Malcolm sautera le pas, effacera le X avec le Malcolm et prendra le nom musulman de el-Hajj Malik el-Shabazz. Produit d'un long passé américain, Malcolm X porte le stigmate d'une identité sous tension, douloureuse, parcourue de tensions et de contradictions. L'historien(ne) doit veiller à les comprendre, les expliquer et, surtout, ne jamais les simplifier ni les figer une bonne fois pour toutes.

Toujours plus complexe, la plongée dans le nom des choses, des hommes et des femmes, est porteuse d'un message d'honnêteté, de probité et de rigueur face au passé, si traumatique fut-il. L'historien(ne) n'est pas Malcolm, s'il nomme, c'est pour toujours mieux comprendre l'entrelacement du passé et du présent, non pour oublier ou promouvoir une mémoire.
Ce qu'un individu peine à faire pour sa vie, l'historien(ne) doit toujours s'efforcer à le faire pour le passé. Ne jamais lui donner au le nom de mémoire, encore moins celui d'une seule mémoire, mais les intégrer toutes, en faire des objets du passé et non le passé lui-même.
A sa façon, en considérant Malcolm mais sans oublier Lenox, New York offre au prolongement nord de la 6th Avenue la chance d'un présent et d'un futur ouvert sur le champ des possibles.
Pour aller plus loin et élargir les perspectives, je vous recommande chaudement cette belle notice relative à l'Autobiography de Malcolm, mémoire du passé complexe d'un homme qui a changé deux fois de noms et conduit New York à renommer, pour moitié, un de ses plus belles avenues.

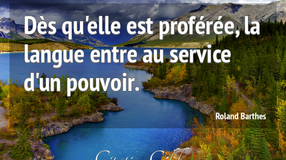

















Commentaires