J'en fais quoi de ma peur, moi ?
- Séverin Duc
- 4 juin 2017
- 4 min de lecture
Au lendemain d'une énième attaque des sicaires de l'ISIS en Europe, il est bienvenu de questionner la peur qui ruisselle dans le cœur de beaucoup. De fait, une séquence de violence nous frappe et depuis de longues années suscite une somme d'angoisses individuelles et collectives. Une séquence qui est partie pour durer et une somme destinée à s'épaissir. Que faire pour ne pas être captif de la peur qui en découle, inévitablement ?
Si l'angoisse ne peut être dépassée, on peut cependant la tenir à distance en résistant à deux pôles magnétiques qui nous maintiennent dans les angles. En effet, la peur n'est jamais aussi forte que lorsqu'on lui cède le rythme de nos vies et de nos sentiments.
Or, certaines attitudes me semble inadéquates, car inopérantes, pour, sinon s'extraire de la peur, du moins la voir telle qu'elle est. Pire, elles me semblent lui donner une force toujours plus asservissante. En revanche, accepter la peur est un acte de résistance. Un acte premier de liberté individuelle. C'est tolérer l'instable. En somme, on ne se noie pas en niant la force de la mer, mais en apprenant à nager.
Alors que faire de sa peur ?
Un outil de soumission dessinant la géographie de nos vies, ou bien, une butte-témoin qui figure et rend nécessaire une action volontaire et vitale d'extraction du système d'angoisse ?
En somme, la peur est autant un signal qu'un piège.
De mon point de vue d'historien, la position que chacun choisit d'adopter vis-à-vis du réel conditionne, pour large part, la façon de le ressentir. Or, il paraît que les moutons effrayés se placent dans les angles d'une pièce, plutôt qu'au centre. Accepter la peur, dépasser l'effroi, prendre une certaine distance pour agir vers le centre.
Je pense que l'hyper-connaissance et conscience du danger ne le réduit pas mais, plutôt semble nous réduire à son empire.
Si les analyses géopolitiques aident à rationaliser, bref à donner du sens, elles ne nous apportent rien pour affronter, psychologiquement, la vague de haine et de violence qui nous frappe. Rationaliser de façon macro n'aide pas à calmer le micro. Je pourrais lire 30 articles du Monde diplomatique, que je connaîtrais parfaitement le Moyen-Orient, mais mes tripes n'en seraient pas moins nouées. Ou, pire, encore regarder la Goebbelssisante BFM TV ne ferait que me réduire dans un coin angoissé de la pièce, comme une souris. Pour que la violence ne devienne pas une obsession, il faut un rapport mesuré et adulte à sa connaissance, laquelle comme toute liberté s'articule à une responsabilité. Celle de ne pas en faire n'importe quoi. Seul un rapport intelligent et modéré à l'information réduira le sentiment de peur, et nous aidera à mieux penser.
A l'opposé de l'hyper-connaissance, je désigne les illusions réconfortantes comme autant de chausse-trappes manufacturées par les producteurs de violence. La binarité tue notre libre-arbitre.
A la va-vite, on trace une "ligne rouge" entre le Bien et le Mal. Il y a deux murs dans la pièce et une ligne de front au centre ? Or, tout n'est qu'illusion et représentation. Par excès de bonne ou mauvaise volonté, on est son propre magicien. On ne comprend rien, et on demeure dans l'angle de la peur.
Ainsi, l'illusion d'un Etat bienveillant et protecteur n'est pas plus valide que celle d'un Etat prédateur et oppresseur. Entre "état d'urgence pas toujours nécessaire" et "urgente nécessité d'Etat", il est fort difficile de trancher. Qui voudrait d'un Paris devenu Bagdad ? Personne. Pourtant, la condition première de notre sécurité (la force publique) représente aussi une menace pour notre liberté. Personnellement, je ne veux pas de "chasse à l'homme" de la part de la DGSE, d'appel à l'éradication, à l'état d'urgence, à la "War on Terror", à Guantanamo, à Abu-Grahib, à la "mère de toutes les bombes", au Front national, etc. Que toutes les guerres de décolonisation forment notre capital d'expériences : les "chasses à l'homme" ne font que nous rapetisser. A l'inverse, une défense, par le renseignement, l'enquête policière et les opérations commando, semblent être une nécessité vitale.
Alors, où placer le curseur ? Comment trancher ? Je ne sais pas. Car on ne "tranche" pas le réel, on le prend dans sa complexité. Seule une approche dialectique et sceptique du réel peut nous faire quitter l'angle de la pièce, telle la souris face au chat, et revenir au centre libre de la pièce.
Comment y revenir ? Seule une discipline individuelle et consciente face aux rafales du réel nous maintiennent au centre. En somme, établir un rapport mesuré à la connaissance : que son objet (la violence) ne devienne pas une obsession, mais une occasion de penser notre rapport à elle, et non d'elle sur nous. Connaître toujours mieux, plutôt que toujours plus.
Pour aller plus loin, et parce que les temps sont suffisamment sombres pour se priver de lyrisme, il me semble que l'on peut commencer par deux magnifiques poèmes de Charles Bukowski :
Reinvent Your Life
“Invent yourself and then reinvent yourself, don't swim in the same slough. invent yourself and then reinvent yourself and stay out of the clutches of mediocrity..."
Your Life is your Life
"...You can’t beat death but you can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be...".

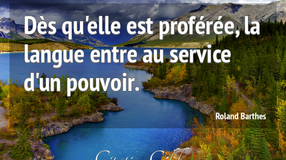

















Comments